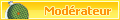D'une manière générale, ce débat sur la nature et la culture me paraît de plus en plus inutile. Justement parce qu'on est à l'interface entre deux ordres. Autant ça a du sens de dire qu'on va se ballader dans la nature, ou qu'on va s'imprégner de la culture de l'Afrique du Nord. Autant dans ce cas, il y a visiblement des enchevêtrements qui rendent obsolètes ce type d'expressions. En bref, arrêtons avec la quête des fondements et des origines puisque ça n'a censément aucune importance sur ce que nous devons faire ou sur comment nous décrivons le monde.
Oui je suis d’accord sur le fait que nous nous trouvons entre les deux ordres. Mais il faut admettre que chacun de nous penche forcément plus pour l’un que pour l’autre afin de justifier tel ou tel choix politique ou vision du monde.
Bon et puis sur la "sociobiologie humaine" et son ambition d'expliquer les comportements sociaux par les coefficients de liaison génétique (ou autre) : on aboutir forcément à des arguments téléologiques ou des propositions tautologiques : plus l'explication placée à l'origine d'une institution possède un caractère général, moins il a de valeur explicative. Lorsque l'explication naturaliste rattache différentes manifestations culturelles à un unique besoin postulé, elle ne fait rien d'autre qu'affirmer la nécessité de la culture comme moyen de traduire ce besoin. C'est un truisme et ça déguise une impuissance à rendre compte du contenu des institutions sociales.
Les arguments ne sont pas toujours si généralistes et on retrouve pas mal de corrélations entre divers sociétés. Je trouve ça un peu facile de réduire tout cela à des arguments téléologiques. Je pourrais dire aussi qu’aller trop dans les détails, devant le nombre de situations, peut nous noyer dans une masse de données dont on ne pourra pas tirer grand-chose. Je peux ajouter aussi que vous prenez pour exemple des cultures très minoritaires qui ne représentent qu’un infime pourcentage de la population humaine pour extrapoler ces faits à l’ensemble de la planète. Et c'est ce que je vais faire, au prochain épisode !
Est-ce normatif ou descriptif ?
Si c'est descriptif, c'est évident. Si c'est normatif (mais ça ne peut pas l'être, non ?), ça n'est pas un très gros argument.
Où veux-tu en venir ?
San999 >>>
Je pense que le problème ici c’est que tu raisonnes toujours à partir de l’exemple de minorités. Par exemple, les études sur le transsexualisme, l’hermaphrodisme dans les années 50, montraient un écart entre le corps et l’identité sexuelle, ou une indétermination sexuelle. Cela a ensuite été extrapolé à l’ensemble des individus, pour élaborer une doctrine n’établissant plus de corrélation entre le sexe et le genre.
Il est vrai qu’il existe toujours des écarts à la moyenne, et il faut voir au cas par cas. Mais ici on raisonne de manière statistique et on essaie d’établir une théorie générale. En tout cas pour moi (très modestement). C’est la méthode de l’idéal-type de Max Weber que tu connais certainement : « On obtient un idéal-type en accentuant unilatéralement un ou plusieurs points de vue et en enchaînant une multitude de phénomènes isolés, diffus et discrets, que l'on trouve tantôt en grand nombre, tantôt en petit nombre, par endroits pas du tout, qu'on ordonne selon les précédents points de vue choisis unilatéralement pour former un tableau de pensée homogène ». Et puis en pratique, dans le domaine du droit, censé régir les règles de vie d’une société, il est nécessaire d’abord d’établir des règles générales, des présomptions… Même si en réalité, personne ne rentre parfaitement dans les cadres théoriques assignés. C’est juste pour avoir une vision plus claire du réel qui paraît toujours confus.
Je crois que c’est notre cerveau qui veut ça. On a besoin de donner une forme à une masse de données. De cette manière, on rationalise les choses, on raisonne par abstraction. De même, chaque société se créé des symboles.
Ensuite tu dis que la dualité homme/femme n’a pas de fondement psychologique et ne serait que symbolique. Comme tu t’en doutes, je pense le contraire. Par exemple, dans les sociétés humaines, les hommes ont tendance à préférer les femmes jeunes et belles, caractéristiques objectives qui se traduisent par le timbre de voix, la symétrie des traits du visage etc… traduisant elles-mêmes un signe de bonne santé susceptible de se transmettre à la descendance. Etrangement, dans la plupart des cultures, 80% des femmes se marient avec un homme plus âgé. Par conséquent, cela implique souvent dans les faits de donner un certain avantage à l’homme, et mettre la femme, selon certains critères, en situation d’infériorité.
Aussi, le taux de testostérone donne statistiquement un avantage à l’homme en termes d’agressivité et d’autorité. D’ailleurs, la violence physique reste globalement une valeur masculine. Les amazones ne restent qu’un mythe.
Encore un autre exemple : statistiquement, un homme a beaucoup plus de chances d’être plus fort physiquement que sa femme, et très souvent, quand c’est son épouse. Donc s’il y a une confrontation entre eux, la femme ne pourra rivaliser avec lui en termes de force physique. C’est pourquoi on estime que la femme, du fait de cette faiblesse, établit une autre stratégie pour prendre le pouvoir : la séduction.
Pour résumer, ce sont des caractéristiques physiques et psychiques qui vont souvent établir tout un tas de rapports dans divers domaines traduisant une dualité homme-femme. Mais ces caractéristiques n’ont qu’une influence potentielle. On parle de prédispositions. Mais est-ce suffisant pour légitimer une société qui assigne telle ou telle tâche à un sexe ?
Pour la religion, je ne sais pas. Je pense que tant que l’homme sera l’homme, il existera toujours un sentiment religieux, qui se manifeste d’une manière ou d’une autre selon les époques. L’homme dans son évolution n’est pas parvenu à un stade où il fait seul usage de sa rationalité.