Comme les autres. D'un côté, si tu es sûr que ce n'est pas pour toi, rien ne sert de s'obstiner. Changer d'orientation peut sembler difficile (voire humiliant selon ton milieu) mais ça peut être la bonne option : mieux vaut maintenant que dans plusieurs années. Dans ce cas, il est temps de réfléchir à ce que tu voudrais faire d'autre. De l'autre, n'oublie pas deux choses. D'abord, comme le dit Foe, les bases d'une formation sont souvent ce qu'il y a de plus rebutant, ça devient en général de plus en plus passionnant. Et ensuite, si j'ai bien compris, il s'agit de ta première année à l'unif ? S'il s'agit de ta première session d'examens, peut-être que le stress joue sur ton ressenti, auquel cas mieux vaut faire de ton mieux, tenter de réussir un max de cours, et remettre ta réflexion à la fin de la session, quand tu auras l'esprit plus clair.
En tout cas je ne parlerais pas d'année "perdue". Un an, c'est pas si long, et ça t'a certainement permis de découvrir énormément de choses, même si elles ne sont pas forcément explicitables.
Blablabla... Le comptoir de l'Union
Re: Blablabla... Le comptoir de l'Union
RMR {l Wrote}:Moi, je peux vous dire qui a raison. C'est Lenidem.
En cas de souci sur le forum, me contacter par MP ou à cette adresse : lenidem.lunionsacree@hotmail.com
-

Lenidem - Administrateur

- Messages: 7788
- Inscription: Mar Août 23, 2011 18:17
- Localisation: Bruxelles
Re: Blablabla... Le comptoir de l'Union
J'ai """perdu""" 4 années en étant à la fac, avant de savoir ce que je voulais vraiment et choisi de me réorienter dans une toute autre branche. C'aura peut-être été long, mais je ne regrette absolument pas mon choix. D'autant que je ne comprends pas comment on peut penser "perdre une année" alors que durant tout ce temps tu as forcément appris des tas de choses, rencontré des gens, vécu des expériences qui t'auront apporté énormément. Un an, c'est rien, et quand on voit le nombre d'étudiants qui se réorientent, surtout en première année, c'est limite "normal". On est à un stade où on se cherche encore, et c'est un sujet d'autant plus important que le choix de ses études, de son futur job...
LE TEST


« Je pense qu'on tient avec le Test et le Sacre les héritiers de ce que furent CFC et l'Empereur Saiyen »
- Tierts -
« C'est tellement romanesque, J'AI AIMÉ PU**** ! *o* »
- Kyra1306 -
« On est dans le haut du panier de ce qu'on trouve sur le forum »
- anonymefromlozane -
- Tierts -
« C'est tellement romanesque, J'AI AIMÉ PU**** ! *o* »
- Kyra1306 -
« On est dans le haut du panier de ce qu'on trouve sur le forum »
- anonymefromlozane -
-

ButterflyAway - Messages: 1257
- Inscription: Dim Fév 23, 2014 20:33
- Localisation: derrière un Bingo Destructeur
Re: Blablabla... Le comptoir de l'Union
La révolte
En cours.
Le plus modeste des êtres...Un homme qui fera peur au plus grand des démons...Celui-là même qui en deviendra le guerrier le plus fidèle...
En cours.
Le plus modeste des êtres...Un homme qui fera peur au plus grand des démons...Celui-là même qui en deviendra le guerrier le plus fidèle...
Le fruit de ses tourments
En cours.
Piégé à cause de ses origines, Thalès va tenter de survivre pour venger son peuple. Mais avant tout, il va devoir se battre contre lui-même, et ce sera bien plus dur que ce qu'il imaginait.
En cours.
Piégé à cause de ses origines, Thalès va tenter de survivre pour venger son peuple. Mais avant tout, il va devoir se battre contre lui-même, et ce sera bien plus dur que ce qu'il imaginait.
-

Point - Messages: 661
- Inscription: Jeu Jan 08, 2015 19:06
- Localisation: Pas là où je devrais
Re: Blablabla... Le comptoir de l'Union
Pour ceux que ça intéresse: Le Vent se Lève suivi d'Akira, ce soir sur Arte.
C'est plus compliqué que ça
-

Hone Dake No Brook - Messages: 1018
- Inscription: Mar Jan 21, 2014 5:13
Re: Blablabla... Le comptoir de l'Union
Je fait la promo du Vent se leve, incroyable DA moins connu que Chihiro ou Mononoké.
Et pendant ce temps a Orlando...
Et pendant ce temps a Orlando...
C'est un θ, il croyait qu'il était τ, mais en fait il est θ.
-

Antarka - Messages: 15646
- Inscription: Dim Avr 27, 2008 10:05
Re: Blablabla... Le comptoir de l'Union
Je viens de croiser deux anciens élèves dans le bus. (Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, J'enseigne le français à des requérants d'asile adultes - ou ados dans quelques cas.) C'est un Pakistanais et une Chinoise. Ils n'ont pas de langue commune dans laquelle ils sont tous les deux complètement à l'aise, ils parlent un peu français et un peu anglais, mais la Chinoise a du mal. Mais ils sont quand même en couple (en tout cas, ils en ont l'air). Je trouve ça touchant. Ce qui est triste, c'est qu'ils sont dans une situation précaire. Le Pakistanais m'a dit qu'elle était tout ce qui lui restait. Bon, je vais pas entrer dans les détails de pourquoi ils sont en situation précaire, cela nécessiterait d'expliquer les lois sur l'asile et les permis de séjour suisses.
-

San999 - Phœnix Violet
- Messages: 12124
- Inscription: Sam Mars 10, 2007 18:06
- Localisation: À côté de la plaque... Toujours à côté... -_-'
Re: Blablabla... Le comptoir de l'Union
Et tu te sens pas de vulgariser un peu ? (ici ou sur le topic du droit).
Je fais un peu de droit des étrangers et ça m'intéresserait de voir comment ça fonctionne chez vous.
Je fais un peu de droit des étrangers et ça m'intéresserait de voir comment ça fonctionne chez vous.
C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence.
-

Lalilalo - Modérateur
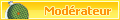
- Messages: 3740
- Inscription: Ven Oct 22, 2010 15:18
Re: Blablabla... Le comptoir de l'Union
BLAGUE À PART, ça avance ou pas sur le LG? é_è
Just a Saiyan in my Soul…
SeyChar D'Assault
https://www.youtube.com/watch?v=JwfsrD792jk
Autant en emporte la Mort…
@Salagir> TentenNokia3310: j'ai pas tenu plus de 8 épisodes. Pourtant je dois le regarder, pour bosser sur 2fight. Mais j'y arrive juste pas.
@Salagir> Il y a tellement de choses + passionnantes qu eje peux faire en 20mn, comme regarder de la peinture sécher
Salagir, au sujet de DBS.
SeyChar D'Assault
https://www.youtube.com/watch?v=JwfsrD792jk
Autant en emporte la Mort…
@Salagir> TentenNokia3310: j'ai pas tenu plus de 8 épisodes. Pourtant je dois le regarder, pour bosser sur 2fight. Mais j'y arrive juste pas.
@Salagir> Il y a tellement de choses + passionnantes qu eje peux faire en 20mn, comme regarder de la peinture sécher
Salagir, au sujet de DBS.
Batroux {l Wrote}:Seychar: Tu es sûrement le plus grand pyromane de l'Union Sacrée.
-

Seychar - Messages: 3990
- Inscription: Sam Jan 08, 2011 15:51
- Localisation: Sur Le Terrain ou alors chez Oswald Fernandez Isaacs
Re: Blablabla... Le comptoir de l'Union
Je peux essayer.Lalilalo {l Wrote}:Et tu te sens pas de vulgariser un peu ? (ici ou sur le topic du droit).
Je fais un peu de droit des étrangers et ça m'intéresserait de voir comment ça fonctionne chez vous.
La première chose que la Suisse décide quand quelqu'un demande l'asile, c'est si sa demande sera étudiée ou non. Une demande d'asile n'est pas étudiée et est automatiquement refusée quand on se trouve dans un "cas Dublin". Avant, il y avait d'autres critères de refus automatique ou de "non entrée en matière" (NEM) comme on les appelle. Sont considérés comme "cas Dublin", tous ceux qui ont déjà déposé une demande d'asile dans un pays signataire des Accords Dublin. Ils sont censés être renvoyés dans le pays où ils ont déposé leur demande. Maintenant, le simple fait d'avoir laissé une trace administrative (contrôle d'identité par exemple) peut être considéré comme un cas Dublin, même si aucune demande d'asile n'a été déposée. J'ai même entendu parler de cas de NEM juste parce que le requérant a admis être passé par un pays signataire de ces accords.
S'il ne s'agit pas d'un cas NEM, le temps que l'étude de la demande soit faite, la personne obtient un permis de séjour provisoire, appelé livret N, renouvelable indéfiniment tous les trois mois. Ce livret permet de travailler (mais n'est pas très séduisant pour les employeurs vu que la personne peut partir du jour au lendemain en trois mois), d'étudier, d'obtenir certaines aides sociales, mais pas le regroupement familial. Certaines personnes gardent ce permis des années, pour d'autres, c'est plus rapide. On vient de voter une loi pour l'accélération des procédures. On verra ce que cela donne.
Plusieurs critères entrent en ligne de compte:
- sûreté du pays d'origine (pour donner une idée de la largesse de cette définition, le Mali ou le Nigeria sont régulièrement présents sur la liste des pays sûrs - plus trop le Nigeria, ces derniers temps, mais ça dépend des régions);
- sûreté d'un pays de transit entre le pays d'origine et la Suisse (ils pourraient demander l'asile dans un pays de transit);
- possession ou non d'une pièce d'identité (si ce n'est pas le cas, en donner la raison et la prouver: si un passeur ou un douanier vous a volé votre pièce d'identité, il faut le prouver);
- si la vie ou l'intégrité physique de la personne était directement menacée (vivre dans une région de conflit n'entre pas dans cette catégorie tant que notre vie n'a pas été immédiatement menacée, de même qu'avoir un membre de sa famille assassiné, ni l'enrôlement de force dans une armée nationale);
- si la personne a pris toutes les mesures nécessaires pour se protéger dans son pays d'origine;
- la capacité à prouver ses dires.
Une large marge de manoeuvre existe pour les décideurs pour statuer sur un dossier. Généralement, cette marge semble être utilisée pour refuser (avis personnel), parce qu'encourager les réfugiés à venir, c'est pas ce veut la confédération. Ainsi, on trouve bel et bien des réfugiés qui viennent pour cause de leur orientation sexuelle, car ils vivent dans un pays dans lequel l'homosexualité est illégale, mais d'un autre côté, je connais un requérant tanzanien homosexuel qui s'est vu refuser sa demande, car il n'a pas pu prouver son homosexualité et le cas échéant, il n'a pas non plus démontré avoir pris toutes les mesures nécessaires pour se cacher.
Ceux qui se voient recevoir une décision positive, obtiennent ce qu'on appelle le permis B. (Permis B également attribué aux travailleurs étrangers habitant depuis moins de cinq ans en Suisse, aux étudiants et aux personnes mariées à des Suisses ou des détenteurs de permis C ou B. Ce permis de séjour est donc subdivisé en plusieurs catégories.) Ce permis permet de travailler, d'étudier, d'avoir accès à certaines aides sociales dans la limite de certains délais, de trouver un appart' et le regroupement familial. La plupart des Srilankais obtiennent le permis B réfugié, par exemple. À noter qu'après cinq ans avec ce permis, il peut se muer en permis C (le permis le plus confortable), sous réserve de correspondre à certains critères.
Si on a pas les critères pour obtenir le permis B, il est alors évalué si le fait d'avoir quitté son pays met la vie ou l'intégrité physique de la personne en danger en cas de retour. On obtient alors le statut de réfugié, avec un livret F politique. C'est ce qu'obtiennent la plupart des Érythréens (à voir si ça reste le cas, puisque la Suisse est actuellement en débat pour renvoyer les Érythréens dans leur pays). Ce permis a cela de différent avec le permis B qu'il est toujours considéré comme un permis provisoire (si la situation du pays d'origine change, on peut se voir retirer son permis), et qu'il est donc plus difficile de trouver du travail avec (en plus la population suisse ne connaît très souvent pas ce permis), de plus il ne permet pas le regroupement familial. Il est renouvelable tous les ans et après cinq ans, il peut se muer en permis B sous réserve de certains critères.
Enfin, si les conditions dans le pays d'origine ne permettent pas de garantir l'intégrité physique de la personne, la personne obtient aussi un livret F. Par exemple, si la personne vient d'un pays en situation de conflit ouvert ou qu'une maladie invalidante ou mettant sa vie en danger ne puisse être traitée dans son pays (ce point laisse encore une très grande marge de manoeuvre aux décideurs). Elle obtient alors aussi le livret F, mais dans ce cas, la personne n'a pas le statut officiel de réfugié et on le nomme livret F humanitaire. C'est ce qu'obtiennent la plupart des Syriens. Pour tout te dire, je ne comprends pas trop la différence avec le livret F politique... Hormis le changement de statut de réfugié à celui de simple requérant d'asile, et du fait que les F humanitaires sont de la responsabilité de mon institution (qui s'occupe aussi des livrets N) et les F politiques sont du ressort d'une autre institution (qui s'occupe aussi des permis B réfugiés).
Maintenant qu'arrive-t-il à ceux qui sont NEM ou qui voient leurs demandes refusées ? Ils ne sont pas systématiquement renvoyés. Parce qu'on ne connaît pas leur pays d'origine, parce que leur pays d'origine ou de renvoi refuse de les reprendre, parce qu'on a pas l'argent ou pas le temps ou je ne sais quoi, pour s'occuper de leur renvoi. Je ne sais pas. Il y a plein de raisons et tout ne m'apparaît pas très clair, je dois dire. Quoi qu'il en soit, ils n'ont alors pas de permis de séjour, mais reçoivent un papier A4 signé et tamponné par une administration suisse responsable de ça, qui certifie que cette personne est en attente de renvoi. Ce papier est renouvelable tous les quinze jours indéfiniment (bien qu'en théorie, cela ne devrait pas être le cas), parfois moins de temps, parfois BEAUCOUP moins. Ce papier permet aux requérants de se rendre à l'institution responsable et d'obtenir deux fois par jour, soit l'équivalent d'un repas en nature, soit un bon, soit une somme d'argent équivalent à la moitié de la valeur d'un de mes repas quand je veux économiser. Autrement, ils n'ont pas le droit de travailler, pas le droit d'étudier (sauf les mineurs depuis quelques années, mais une fois devenus majeurs, fini, à part parfois de petits dérogations d'un an pour finir une formation), pas le droit de se marier, pas le droit aux aides sociales usuelles, pas le droit de signer un contrat quel qu'il soit. Ils vivent soit en abri de protection civil (avec ceux qui viennent d'arriver), soit en détention (mais pour une courte durée, normalement, en tout cas une courte durée à la suite, mais ils peuvent être détenus pour la même durée plusieurs fois). On leur paie quand même les soins médicaux. C'est ce qu'on appelle l'aide d'urgence, ou ce que les requérants nomment eux-mêmes le papier blanc.
Pour les NEMs, s'ils ne sont pas renvoyés dans le pays dans les six mois, ils peuvent alors représenter leur dossier qui sera alors étudié. Cependant, s'ils disparaissent de la nature, le compteur est stoppé, et reprend uniquement à leur réapparition. Donc, par exemple, si un NEM reste à disposition des autorités durant deux mois, puis disparaît quatre mois avant de réapparaître, alors seuls les deux premiers mois sont pris en compte.
Pour les autres « papiers blancs », leur demande pourra être réétudiée, s'ils sont présents sur le territoire suisse depuis au moins cinq ans (oui, c'est possible, certains vivent avec ce statut pendant dix ans). Cela dit, plus ils sont présents en Suisse depuis longtemps, plus il y a de chances qu'on essaie quand même de leur trouver des apparts ou des studios soit en colloque soit seuls, ou encore qu'ils bénéficient d'une mesure sociale quelconque (pas d'aide financière ou autre truc de ce genre), mais plutôt des mesures d'occupation. Enfin, dans mon canton, mais je crois que c'est le seul qui fait ça.
En l'occurrence, les deux élèves que j'ai croisés ont, l'un (le Pakistanais) le "papier blanc" et l'autre (la Chinoise), le livret N depuis plus d'un an et demi.
-

San999 - Phœnix Violet
- Messages: 12124
- Inscription: Sam Mars 10, 2007 18:06
- Localisation: À côté de la plaque... Toujours à côté... -_-'
Re: Blablabla... Le comptoir de l'Union
Yo les gens.
J ai le forum indisponible 9 essai sur 10, quelle que soit l heure, depuis le week end dernier. Rien que la j en suis a 14 essai pour poster ca (avec modification de mon C/C a chaque fois).
Je suis le seul ?
Edit : la 14eme est la bonne !!!
J ai le forum indisponible 9 essai sur 10, quelle que soit l heure, depuis le week end dernier. Rien que la j en suis a 14 essai pour poster ca (avec modification de mon C/C a chaque fois).
Je suis le seul ?
Edit : la 14eme est la bonne !!!
C'est un θ, il croyait qu'il était τ, mais en fait il est θ.
-

Antarka - Messages: 15646
- Inscription: Dim Avr 27, 2008 10:05
Re: Blablabla... Le comptoir de l'Union
Pareil. Pas exactement de la même façon qu'Antarka, mais on va pas faire dans le détail.
-

San999 - Phœnix Violet
- Messages: 12124
- Inscription: Sam Mars 10, 2007 18:06
- Localisation: À côté de la plaque... Toujours à côté... -_-'
Re: Blablabla... Le comptoir de l'Union
Oui, moi aussi je suis très souvent refoulée.. faut être motivé pour venir sur le fofo en ce moment.
Le futur me donne un peu trop souvent l'impression d'avoir les mots de Dante « Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance » gravés en lettres sombres sur son fronton.
-

Foenidis - Messages: 11818
- Inscription: Mar Avr 28, 2009 22:33
- Localisation: Suivez mon actualité sur Twitter, cherchez @Foenidis
Re: Blablabla... Le comptoir de l'Union
Essayez de supprimer les cookies, ça va peut-être reduire un peu l'indisponibilité, y a pas grand-chose d'autre à faire pour le moment.
-

Tinky Dan Dan - Princesse de L'Union Sacrée
- Messages: 4584
- Inscription: Ven Août 12, 2011 0:44
Re: Blablabla... Le comptoir de l'Union
De même, ça me le fait très souvent en ce moment, que ce soit via, mon PC, au boulot, ou via mon tel !
-

goten-kun - Messages: 8348
- Inscription: Lun Nov 10, 2008 18:04
Re: Blablabla... Le comptoir de l'Union
Ok merci San. Désolé, j'ai pas pu répondre avant car j'ai également des problèmes de connexion...
C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence.
-

Lalilalo - Modérateur
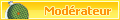
- Messages: 3740
- Inscription: Ven Oct 22, 2010 15:18
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités



