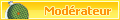Les deux vont émettre une hypothèse, étudier des sources pour l'un et computer des données, pour finalement apporter une conclusion, qui n'a rien de définitif (en histoire comme en biologie, un travail est valide jusqu'à ce qu'un autre travail vienne prouver le contraire).
Non. En science, une hypothèse est validée par l’expérimentation et sa reproductibilité. La conclusion est définitive. Mais la démarche scientifique consiste à rester conscient que la possibilité qu’il puisse y avoir une autre conclusion un jour reste possible même si elle est infiniment peu probable. Exemple : la terre est "ronde".
La conclusion est définitive.
Autre exemple :
Le sang transporte le dioxygène et les éléments nutritifs nécessaires aux processus vitaux de tous les tissus du corps, ainsi que les déchets, tels que le dioxyde de carbone ou les déchets azotés, vers les sites d'évacuation.
La conclusion est définitive.
Ce n’est pas la même chose en sociologie ou en histoire.
Selon Aristote, une science doit toujours porter sur des objets universels et nécessaires, et l'on peut prétendre posséder la science quant à un objet quand on peut énoncer sa ou ses diverses causes (le « pourquoi » de cet objet et de son existence).
D'autre part, on sait que la science doit être universelle, et ce aux deux sens du terme : elle doit être toujours vraie, mais aussi vraie pour tous. On dira aussi en ce sens qu'elle doit être « objective », c'est-à-dire ne pas dépendre d'une subjectivité particulière, ni varier selon les individus.
Il nous reste alors à nous demander si l'histoire est ou non conforme à ces divers critères de scientificité.
L'histoire en effet ne détermine pas des lois ou des enchaînements universels de causes et d'effets, comme le fait la science physique, mais elle étudie des cas particuliers ; c'est pourquoi selon Schopenhauer « elle est une connaissance sans être une science, car nulle part elle ne connaît le particulier par le moyen de l'universel, mais elle doit saisir immédiatement le fait individuel, et, pour ainsi dire, elle est condamnée à ramper sur le terrain de l'expérience ».
L'historien ne peut pas renoncer à toute subjectivité : quel homme pourrait véritablement n'être « d'aucun lieu ni d'aucun temps » ? Nous allons nécessairement vers l'étude du passé avec les connaissances, les opinions propres à notre époque et à notre pays, et ne saurions en faire totalement abstraction.
Mais, plus encore, il faut comprendre que l'historien nedoit pas renoncer à sa subjectivité propre, et ce pour deux raisons :
D'une part, il faut dire qu'une histoire absolument objective perdrait toute signification ; comment raconter « objectivement » l'assassinat de César ? Faut-il le réduire à une série de mouvements décrits à la manière de la science physique ? Ne faut-il pas au contraire tenir compte des composantes humaines, subjectives, de cet événement ?
D'autre part, l'histoire n'a de sens et d'intérêt pour nous que si l'historien va à l'encontre du passé muni de sa propre subjectivité, de sa faculté propre de compréhension envers des êtres lointains et différents de nous.
Cette part de subjectivité et ce refus d'une objectivité pure, qui sont le propre de la connaissance historique, peuvent être synthétisés sous le nom de « compréhension » : ce principe signifie que l'historien tente non pas seulement de décrire, mais de comprendre, les événements et personnes du passé, de sympathiser pour ainsi dire avec eux ; il a en outre à faire preuve d'esprit critique à l'égard des faits, qu'il doit interpréter et relier de façon à leur donner un sens.
En ce sens, il faut dire que l'histoire appartient au domaine, non des sciences de la nature, mais des sciences dites « humaines », qui ont leurs exigences propres : si les phénomènes naturels doivent être expliqués suivant la seule catégorie causale, dira Dilthey, les phénomènes humains quant à eux requièrent d'être compris,c'est-à-dire interprétés et replacés dans leur contexte historique afin d'être rendus, par et pour nous, lecteurs et historiens du présent, signifiants.
Enfin, c'est bien beau de dire ça, mais Zemmour en tant que polémiste, et Onfray en tant que philosophe, ils sont clairement du coté des sciences interprétatives, donc leur propos seraient un poil hypocrite dans ton interprétation non ?
D'ailleurs Onfray à plusieurs fois déclaré que le philosophe devait s'appuyer sur les travaux de la sociologie, des sciences dures et des sciences humaines...
Ce n’est pas parce que les sciences humaines ne sont pas de vraies sciences qu’il faut tout jeter. J’espère que tu m’as compris sur ce point. Simplement, il peut y avoir des débats au sein de ces disciplines qui ne seront peut-être jamais tranchés.
Et ce qui est gênant ces dernières années, c’est qu’on érige des hypothèses sociologiques au rang de vérité scientifique à tel point que certains s’excitent dès qu’une personne avec un esprit suffisamment critique se pose des questions à voix haute sur ces soi-disantes vérités scientifiques qui n’en sont pas.
Je ne vise pas que ce forum. Ce qui s’y passe ou s’y est passé peut être observé sur les réseaux sociaux ou dans les médias.
Enfin, la sociologie est une discipline très proche de la philosophie, donc il est tout à fait normal qu’un philosophe s’appuie dessus ENTRE AUTRES disciplines et sciences.
J’espère avoir été précis avec respect, cher Axaca.